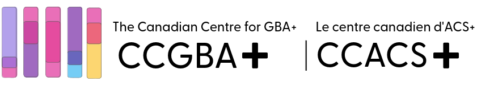Le Consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) est un principe consacré par le droit international des droits de l’homme, notamment dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et d’autres accords internationaux comme la Convention 169 de l’OIT. Le CLPE garantit aux peuples autochtones le droit d’accorder ou de refuser leur consentement aux projets, lois ou activités susceptibles d’affecter leurs terres, leurs ressources ou leurs vies. Il garantit aux peuples autochtones une véritable participation aux décisions qui pourraient changer leur vie, particulièrement en ce qui concerne leurs terres, leurs ressources et leurs cultures, comme moyen de remédier aux injustices historiques et de construire des partenariats authentiques.
Que signifie réellement le CLPE ?
- Libre : La décision doit être prise sans pression ni manipulation. Pas d’intentions cachées, pas de conditions. Il s’agit de s’assurer que les gens se sentent en sécurité et habilités à dire « oui », « non » ou « pas encore ».
- Préalable : Le moment est crucial. On n’attend pas que les plans soient finalisés ou que les machines arrivent pour demander l’avis. Les communautés autochtones doivent être intégrées à la conversation dès le début pour que leurs voix soient inscrites dans l’ADN des projets et des politiques.
- Éclairé : Chacun mérite de savoir ce qu’il accepte (ou non). Cela signifie fournir des informations claires et précises sur ce qui est prévu, les risques encourus et les avantages potentiels. Et cela doit être fait d’une manière compréhensible pour les personnes concernées.
- Consentement : C’est la décision collective de la communauté d’accepter, de rejeter ou de négocier. Ce n’est pas une case à cocher ni une approbation symbolique.
Quand le CLPE est-il nécessaire ?
Le CLPE intervient chaque fois qu’un projet pourrait avoir un impact sur les terres ou les ressources autochtones. Qu’il s’agisse d’exploitation minière, de construction d’un barrage ou de création d’une zone de conservation, les personnes concernées ont le droit de décider si et comment le projet doit avancer.
Pourquoi le genre et l’intersectionnalité sont importants
Le genre, l’âge, le handicap et d’autres facteurs influencent le fait de qui est entendu et quels besoins sont prioritaires. Par exemple, les femmes gèrent souvent les systèmes d’eau et d’alimentation, mais sont fréquemment exclues des discussions formelles. Les aînés apportent des connaissances traditionnelles, tandis que les jeunes offrent des perspectives innovantes, mais ces deux groupes sont parfois négligés. Sans inclusion intentionnelle, le CLPE risque de renforcer les inégalités existantes.
Comment appliquer le CLPE de manière inclusive
Pour que le CLPE fonctionne pour tous, il est important de créer un espace pour les voix diverses. Les informations doivent être partagées dans des langues et des formats compréhensibles pour tous dans la communauté, et le processus doit prévoir suffisamment de temps pour que les gens puissent discuter et comprendre les implications. Les femmes et autres groupes marginalisés peuvent avoir besoin d’espaces dédiés pour s’exprimer librement sans crainte de jugement ou de représailles. Répondre à ces besoins renforce le processus et garantit que la décision finale reflète l’ensemble de la communauté, pas seulement ceux qui ont le plus d’influence.
Ressources
- Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause : Un droit des peuples autochtones et une bonne pratique pour les communautés locales.
Ce manuel est publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il fournit des étapes claires et des outils pour aider les projets à suivre les normes internationales comme la DNUDPA et la Convention 169 de l’OIT. - Le consentement libre, préalable et éclairé dans le contexte de la DNUDPA et des évaluations environnementales
Le document a été produit par le Bureau d’évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique. Il reflète l’engagement de la province à intégrer le CLPE dans son processus d’évaluation environnementale conformément à la DNUDPA.