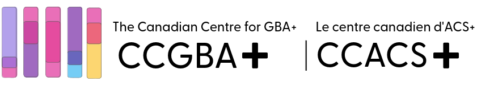Introduction
Les effets de la dégradation environnementale et des changements climatiques ne sont pas répartis équitablement entre les populations. Les communautés autochtones au Canada supportent souvent un fardeau disproportionné en raison des inégalités systémiques, de l’exclusion historique et de l’accès limité aux ressources. Ces défis sont aggravés par les héritages coloniaux qui ont perturbé les pratiques traditionnelles et diminué l’accès aux ressources environnementales et économiques essentielles. Le changement climatique exacerbe ces problèmes systémiques, les événements météorologiques extrêmes tels que les inondations, les feux de forêt et les sécheresses affectant de manière disproportionnée les communautés autochtones.
Cette revue de la littérature explore l’intersection des systèmes environnementaux et sociaux, en se concentrant sur le contexte historique de l’injustice environnementale, les impacts sur la santé et l’économie, et les vulnérabilités uniques auxquelles font face les diverses populations autochtones.
Contexte historique de l’injustice environnementale
L’injustice environnementale au Canada est profondément enracinée dans les histoires coloniales qui excluent les voix autochtones. Des politiques telles que les déplacements forcés et l’établissement des pensionnats ont ancré les inégalités systémiques, perturbant les pratiques traditionnelles et affaiblissant les liens communautaires (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019). Les politiques coloniales, y compris la Loi sur les Indiens, ont fondamentalement perturbé les pratiques traditionnelles de gestion des terres en imposant des systèmes de propriété foncière et de gouvernance qui privilégiaient les industries extractives et l’exploitation des ressources au détriment de la souveraineté et de l’autodétermination autochtones (Hanrahan, 2017). Ces politiques ont non seulement dépossédé les communautés autochtones de leurs terres ancestrales, mais ont également érodé les systèmes de connaissances traditionnelles essentiels à la durabilité environnementale. L’impact de ces perturbations est encore aggravé par l’infrastructure inadéquate dans les territoires autochtones, y compris des systèmes d’eau et de logement insuffisants, qui créent des obstacles systémiques à la justice économique et environnementale (Bradford et al., 2016 ; Rapport sur la résilience autochtone, 2024).
Les projets d’extraction des ressources, tels que l’exploitation minière, l’exploitation forestière et les développements hydroélectriques, continuent d’empiéter sur les terres autochtones, causant des impacts environnementaux généralisés, notamment la déforestation, la contamination de l’eau et la perte de biodiversité. Par exemple, la catastrophe de la mine Mount Polley a mis en évidence les risques associés aux bassins de résidus mal réglementés (Sosa & Keenan, 2001). Ces projets perturbent les écosystèmes essentiels au bien-être culturel et physique des peuples autochtones, exacerbant les vulnérabilités aux impacts des changements climatiques, y compris l’altération des schémas de migration de la faune et la perte de terres arables (Bunce et al., 2016 ; Reyes-García et al., 2024). De plus, le manque de consultation appropriée avec les communautés autochtones viole les principes fondamentaux tels que le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE), comme souligné dans les cadres nationaux (Sosa & Keenan, 2001). Les violations du CLPE marginalisent davantage les communautés autochtones et exacerbent la dégradation écologique de leurs territoires.
Des études récentes documentent comment le manque de couvert forestier urbain et les infrastructures publiques mal entretenues exacerbent les risques pour la santé, particulièrement pendant les vagues de chaleur, qui augmentent en fréquence en raison du changement climatique (Reyes-García et al., 2024 ; Fuentes et al., 2020). Par exemple, de nombreuses communautés autochtones éloignées dépendent de générateurs diesel, qui sont coûteux et nocifs pour l’environnement. La transition vers des sources d’énergie renouvelable offre une voie viable vers la souveraineté énergétique durable pour ces communautés (Sarkar et al., 2015 ; Zambrano-Alvarado & Uyaguari-Diaz, 2024 ; Hanrahan, 2017). De même, les effets d’îlot de chaleur urbain touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones vivant dans des quartiers densément peuplés à faible revenu avec des espaces verts limités. Ces tendances soulignent le besoin urgent d’une planification urbaine inclusive qui aborde la justice environnementale et priorise le développement d’espaces verts dans les quartiers historiquement mal desservis (Reed et al., 2024 ; Miller, 2021).
Les conséquences culturelles de l’extraction des ressources sont tout aussi graves. Ces activités profanent souvent des sites sacrés, interrompent les pratiques cérémoniales et perturbent les modes de vie traditionnels. Manning et al. (2018) soutiennent que cela conduit à un traumatisme intergénérationnel, approfondissant la fracture socioculturelle causée par des siècles d’exploitation coloniale. Les structures de gouvernance qui privilégient les intérêts industriels et gouvernementaux au détriment de la souveraineté autochtone perpétuent ces préjudices, laissant les voix autochtones marginalisées dans les décisions politiques et sapant les efforts pour une gestion équitable des ressources.
De plus, l’exclusion des perspectives autochtones de la gouvernance environnementale conduit à des politiques qui répondent inadéquatement aux besoins localisés. Kemp et al. (2024) soulignent que l’intégration des Systèmes de Connaissances Autochtones (SCA) dans les processus décisionnels est essentielle pour une gestion environnementale durable. Hanrahan (2017) souligne que négliger l’apport autochtone renforce les inégalités systémiques et perpétue les échecs de la gouvernance des ressources. Ces obstacles structurels mettent en évidence le besoin urgent de politiques qui intègrent le leadership autochtone et privilégient des partenariats équitables pour traiter efficacement les injustices environnementales de longue date.
Impacts sur la santé et sociaux
La dégradation environnementale et les défis climatiques auxquels font face les communautés autochtones au Canada ont des implications profondes sur la santé et le social. Les changements environnementaux, y compris la contamination des sources d’eau et les perturbations des écosystèmes, affectent directement le bien-être physique et mental de ces populations. Par exemple, les polluants issus des activités minières, tels que le mercure et l’arsenic, ont été liés à des taux accrus de maladies chroniques dans les régions touchées (Williams et al., 2018). La contamination au mercure est particulièrement nocive, car elle se bioaccumule dans les poissons (un aliment de base pour de nombreuses communautés autochtones), et pose de graves risques pour la santé, notamment des dommages neurologiques, des retards de développement chez les enfants et un risque accru de maladies cardiovasculaires. L’exposition chronique au mercure par l’eau et les sources alimentaires traditionnelles n’affecte pas seulement la santé physique mais conduit également à une perte en cascade des pratiques traditionnelles comme la pêche, approfondissant davantage la déconnexion culturelle et les défis de santé mentale (Sarkar et al., 2015 ; Hanrahan, 2017).
Les réserves autochtones connaissent des avis d’ébullition d’eau chroniques, une situation où les communautés sont averties que leur eau du robinet n’est pas sûre à boire ou à utiliser sans la faire bouillir d’abord. Cela reflète une négligence systémique et un sous-investissement, car ces avis persistent souvent pendant des années, laissant les communautés sans accès fiable à l’eau potable (Williams et al., 2018). L’insécurité hydrique, vécue par des communautés comme celles qui dépendent de la rivière Attawapiskat, affecte non seulement l’hydratation et l’assainissement, mais aussi la sécurité alimentaire en perturbant les pratiques de pêche et d’agriculture (Hanrahan, 2017).
Les impacts sur la santé mentale sont particulièrement aigus, découlant de l’érosion des connexions culturelles à la terre et du stress composé de la perte environnementale. Des études documentent comment les déplacements forcés dus aux inondations ou à l’extraction des ressources exacerbent les taux de dépression, d’anxiété et de consommation de substances dans les communautés autochtones (Manning et al., 2018). Ces déplacements rompent souvent les liens avec les terres ancestrales, qui sont centrales à l’identité et aux pratiques culturelles, contribuant au traumatisme intergénérationnel.
Pour atténuer ces défis de santé et sociaux, les experts appellent à l’intégration des cadres de santé autochtones dans les politiques nationales. Cela inclut la priorisation de l’accès aux services de santé culturellement appropriés, l’investissement dans des mesures préventives comme l’infrastructure d’eau propre, et l’attention aux besoins de santé mentale des populations déplacées à travers des programmes tenant compte des traumatismes (Reed et al., 2024)
Impact économique
Les économies autochtones sont fondées sur des principes de réciprocité et de durabilité, mettant l’accent sur la gestion relationnelle de la terre et les économies autochtones soulignent la réciprocité et la durabilité, en mettant l’accent sur des relations équilibrées avec la terre et les ressources. En contraste frappant, le capitalisme, de concert avec le colonialisme, transforme la terre en un actif marchandisé, privilégiant le profit par rapport à la signification culturelle et écologique. Comme l’observe justement Coulthard (2013), « Le colonialisme et le capitalisme opèrent main dans la main, renforçant les structures qui privilégient la marchandisation des terres au détriment de la gouvernance autochtone et de la survie culturelle. »
Les communautés autochtones au Canada font face à des défis importants pour affirmer leur contrôle sur les décisions liées à la location, aux permis et aux licences sur leurs terres et leurs eaux, rencontrant souvent des obstacles systémiques et de la résistance. Cela soulève des questions sur ceux qui détiennent l’autorité pour prendre des décisions économiques : par exemple, le développement des ressources, les projets d’infrastructure et d’autres considérations d’utilisation des terres (Reed et al., 2024).
Les écosystèmes altérés et les ressources fauniques épuisées sapent les moyens de subsistance durables, tels que la pêche et la récolte, qui sont intégraux aux cultures et aux économies autochtones (Reed et al., 2024). Par exemple, le déclin des populations de saumon, une ressource essentielle pour de nombreuses communautés autochtones, a des conséquences économiques et culturelles profondes. La perte de ces pratiques traditionnelles perturbe le transfert des connaissances intergénérationnelles et l’autodétermination communautaire. Les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA), conçues pour partager les revenus, échouent fréquemment à inclure une participation autochtone significative ou à traiter les dommages environnementaux causés par les activités d’extraction (Sosa & Keenan, 2001).
Défis intersectionnels
Les femmes autochtones jouent des rôles vitaux en tant que soignantes et pourvoyeuses, assurant l’accès à la nourriture, à l’eau et au logement pour leurs familles et communautés (Hanrahan, 2017). Les changements environnementaux, tels que l’insécurité hydrique et la dégradation des terres, augmentent ces responsabilités, car les avis d’ébullition d’eau chroniques perturbent l’accès à l’eau potable et exigent un travail supplémentaire pour assurer la santé et l’assainissement des ménages (Williams et al., 2018 ; Hanrahan, 2017). Cette intensification du travail est aggravée par la disponibilité réduite des sources alimentaires traditionnelles en raison des cours d’eau pollués et des écosystèmes perturbés, impactant directement la capacité des femmes à maintenir les pratiques traditionnelles et la sécurité alimentaire (Williams et al., 2018). Malgré leurs rôles essentiels en tant que gardiennes de l’environnement, les femmes autochtones manquent fréquemment du soutien institutionnel nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies d’adaptation communautaires et sensibles au genre (Simms et al., 2016 ; Reed et al., 2024).
Les implications sur la santé de la dégradation environnementale affectent de manière disproportionnée les femmes autochtones. L’exposition aux polluants comme le mercure et l’arsenic, sous-produits courants des activités minières et industrielles, est liée aux maladies chroniques et aux effets néfastes sur la santé reproductive (Sarkar et al., 2015 ; Williams et al., 2018). Leurs responsabilités les placent souvent en interaction directe avec des sources d’eau et de nourriture contaminées, exacerbant leur exposition et leur vulnérabilité aux risques pour la santé (Hanrahan, 2017). De plus, le stress de la dégradation environnementale et ses effets en cascade sur la santé familiale et communautaire amplifient les défis de santé mentale, y compris la dépression et l’anxiété, qui sont encore aggravés par une vulnérabilité accrue à la violence et à l’exploitation dans les régions dépendantes des ressources où les services sociaux sont rares (Manning et al., 2018 ; Fuentes et al., 2020). L’afflux de travailleurs transitoires dans les projets d’extraction de ressources exacerbe ces défis, corrélant avec une augmentation des incidents de violence basée sur le genre, d’exploitation et de traite (Williams et al., 2018). Ces facteurs de stress qui se chevauchent soulignent l’intersection entre la dégradation environnementale, les crises de santé mentale et les risques systémiques de violence auxquels font face les femmes autochtones et les personnes de genre divers.
Les jeunes et les aînés au sein des communautés autochtones connaissent également des défis uniques. Les jeunes font souvent face au déplacement en raison de catastrophes environnementales, qui perturbent leur éducation et leurs réseaux sociaux, aggravant les impacts socioéconomiques à long terme sur les générations futures (Manning et al., 2018). Les aînés, qui sont des gardiens essentiels du savoir, sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé liés au climat et à la perte des terres traditionnelles, ce qui diminue leur capacité à transmettre les pratiques culturelles et la sagesse (Reed et al., 2024).
L’emplacement géographique aggrave encore ces vulnérabilités. Les communautés autochtones éloignées et nordiques connaissent fréquemment des retards dans la réception de l’aide d’urgence lors d’événements météorologiques extrêmes, ainsi que des déficits persistants d’infrastructure qui entravent les efforts d’adaptation (Hanrahan, 2017). Les communautés qui dépendent des pratiques traditionnelles, comme la chasse et la pêche, font face à des menaces existentielles alors que les écosystèmes sont dégradés et que les schémas de la faune sont altérés par les changements climatiques (Williams et al., 2018).
Recommandations
1. Leadership et systèmes de connaissances autochtones
- Assurer que le leadership autochtone est central dans la gouvernance environnementale en mettant en œuvre des cadres qui privilégient le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) et l’intègrent avec l’ACS+.
- Incorporer les systèmes de connaissances autochtones (SCA) dans les politiques d’adaptation climatique et environnementales pour améliorer la durabilité et la résilience communautaire.
- Investir dans des programmes de renforcement des capacités qui donnent la barre aux communautés autochtones pour diriger la surveillance environnementale et la gestion des ressources.
2. Infrastructure durable
- Prioriser le développement et l’entretien de l’infrastructure d’eau propre pour éliminer les avis d’ébullition d’eau dans les communautés autochtones.
- Soutenir les initiatives communautaires d’énergie renouvelable pour remplacer la dépendance aux générateurs diesel par des solutions énergétiques durables.
- Développer une infrastructure résiliente au climat, y compris les défenses contre les inondations, le logement et le transport, pour atténuer les impacts des événements météorologiques extrêmes.
3. Disparités en matière de santé
- Élargir l’accès aux services de santé qui sont culturellement sensibles, y compris le soutien en santé mentale tenant compte des traumatismes pour les communautés affectées par le déplacement environnemental.
- Établir des programmes de surveillance de la santé pour suivre les effets des polluants comme le mercure et l’arsenic sur les populations autochtones et mettre en œuvre des interventions ciblées.
- Aborder les risques uniques pour la santé auxquels font face les femmes autochtones et les personnes de genre divers en développant des programmes de santé sensibles au genre.
4. Résilience économique
- Promouvoir la revitalisation des moyens de subsistance traditionnels tels que la pêche, la chasse et la récolte, qui sont intégraux aux cultures et aux économies autochtones.
- Soutien à l’entrepreneuriat : Faciliter l’entrepreneuriat dirigé par les autochtones
- Réformer les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) pour assurer une distribution équitable des revenus et l’inclusion des communautés autochtones dans la gestion des ressources.
5. Gouvernance et responsabilité
- Développer des politiques qui abordent explicitement la justice environnementale et priorisent les ressources pour les communautés disproportionnellement affectées par les changements climatiques.
- Établir des organismes de surveillance indépendants pour superviser la conformité aux réglementations environnementales et aux engagements du CLPE.
6. Éducation et sensibilisation
- Soutenir les initiatives d’éducation climatique qui incluent les perspectives autochtones et mettent l’accent sur l’intendance environnementale.
- Promouvoir les stratégies climatiques dirigées par les Autochtones comme modèles de gouvernance environnementale internationale, en s’inspirant d’initiatives réussies comme les programmes de gardiens autochtones
- Lancer des campagnes pour sensibiliser aux impacts de la dégradation environnementale sur les communautés autochtones et promouvoir l’alliance dans la défense du changement systémique.
- Investir dans des programmes pour les jeunes qui se concentrent sur le développement du leadership et l’action climatique, assurant que la prochaine génération est équipée pour faire face aux défis environnementaux.
Conclusion
Il est évident que les communautés autochtones du Canada sont confrontées à un fardeau disproportionné de dégradation de l’environnement et de changements climatiques, ce qui a des répercussions sur leur bien-être social, économique et sanitaire. Ces défis sont enracinés dans des inégalités systémiques et des politiques coloniales qui perturbent les pratiques traditionnelles et l’accès aux ressources. Pour résoudre ces problèmes, il est impératif de prendre des mesures immédiates afin d’intégrer le leadership autochtone, les systèmes de connaissances traditionnels et des réformes politiques ciblées. Ces mesures sont essentielles pour réparer les injustices historiques et créer des solutions durables qui soutiennent l’autodétermination et la résilience des peuples autochtones.
Références
Alook, A., Eaton, E., Gray-Donald, D., Laforest, J., Lameman, C., & Tucker, B. (2023). The End of This World: Climate Justice in So-Called Canada [La fin de ce monde : La justice climatique dans le soi-disant Canada]. Between the Lines.
Baker, J., & Westman, C. N. (2024). Extracting knowledge: Social science, environmental impact assessment, and Indigenous consultation in the oil sands of Alberta, Canada [Extraction du savoir : Sciences sociales, évaluation des impacts environnementaux et consultation autochtone dans les sables bitumineux de l’Alberta, Canada]. Anthropological Quarterly, 97(1), 1-25.
Bradford, L. E. A., Bharadwaj, L. A., Okpalauwaekwe, U., & Waldner, C. L. (2016). Drinking water quality in Indigenous communities in Canada and health outcomes: A scoping review [Qualité de l’eau potable dans les communautés autochtones du Canada et résultats pour la santé : Une revue de portée]. International Journal of Circumpolar Health, 75(1), 32336. https://doi.org/10.3402/ijch.v75.32336.
Bunce, A., Ford, J., Harper, S., Edge, V., & IHACC Research Team. (2016). Vulnerability and adaptive capacity of Inuit women to climate change: A case study from Iqaluit, Nunavut [Vulnérabilité et capacité d’adaptation des femmes inuites aux changements climatiques : Une étude de cas à Iqaluit, Nunavut]. Natural Hazards, 83, 1419-1441. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2398-6.
Coulthard, G. S. (2014). Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition [Peau rouge, masques blancs : Rejeter la politique coloniale de la reconnaissance]. University of Minnesota Press.
Datta, R., Chapola, J., Waucaush-Warn, J., Subroto, S., & Hurlbert, M. (2024). Decolonizing meanings of climate crisis and land-based adaptations: From Indigenous women’s perspectives in Western Canada [Décoloniser les significations de la crise climatique et des adaptations basées sur la terre : Perspectives de femmes autochtones dans l’Ouest canadien]. Women’s Studies International Forum, 104, 102913. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102913.
Eckert, L. E., Claxton, N. X., Owens, C., Johnston, A., Ban, N. C., Moola, F., & Darimont, C. T. (2020). Indigenous knowledge and federal environmental assessments in Canada: Applying past lessons to the 2019 impact assessment act [Savoir autochtone et évaluations environnementales fédérales au Canada : Application des leçons passées à la Loi sur l’évaluation d’impact de 2019]. FACETS, 5(1), 67–90. https://doi.org/10.1139/facets-2019-0039.
Farrell, C. E., Simard, J., Louttit, S., Southee, F. M., Cruz-Font, L., Struthers, D. P., & O’Connor, C. M. (2024). Occupancy, movement, and behaviour of namew (lake sturgeon Acipenser fulvescens) in an intact river in Canada [Occupation, mouvement et comportement du namew (esturgeon jaune Acipenser fulvescens) dans une rivière intacte au Canada]. Endangered Species Research, 54, 59–81. https://doi.org/10.3354/esr01325.
Hanrahan, M. (2017). Water (in)security in Canada: National identity and the exclusion of Indigenous peoples [(In)sécurité hydrique au Canada : Identité nationale et exclusion des peuples autochtones]. British Journal of Canadian Studies, 30(1), 1–25. https://doi.org/10.3828/bjcs.2017.4.
Kemp, C., Yarchuk, K., Menzies, A., Perron, N., Noganosh, S., Northrup, J., & Popp, J. (2024). Weaving ways of knowing in practice: A collaborative approach to prioritizing community knowledge and values in wildlife camera monitoring with Magnetawan First Nation [Tisser les modes de savoir en pratique : Une approche collaborative pour prioriser les connaissances et les valeurs communautaires dans le suivi de la faune par caméra avec la Première Nation de Magnetawan]. FACETS, 9, 1–17. https://doi.org/10.1139/facets-2024-0030.
Manning, S., Nash, P., Levac, L., Stienstra, D., & Stinson, J. (2018). Impacts of resource extraction for Indigenous women [Impacts de l’extraction des ressources sur les femmes autochtones]. Canadian Research Institute for the Advancement of Women. https://doi.org/10.xxxx/resource-extraction.
McGregor, D. (2021). Indigenous knowledge systems in environmental governance in Canada [Systèmes de savoirs autochtones dans la gouvernance environnementale au Canada]. KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies, 5(1). https://doi.org/10.18357/kula.148.
Miller, S. (2021). Women in power: Learning through climate emergency declarations in Canada [Les femmes au pouvoir : Apprendre des déclarations d’urgence climatique au Canada] [Mémoire de maîtrise, Lakehead University]. Lakehead University Research Repository. (Note: « Master’s thesis » is translated to « Mémoire de maîtrise »)
National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. (2019). Reclaiming power and place: The final report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls [Reconquérir le pouvoir et la place : Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées] (Vol. 1a & 1b). Government of Canada.
Perkins, P. E. (2024). Canadian Indigenous female leadership and political agency on climate change [Leadership féminin autochtone canadien et action politique sur le changement climatique]. Dans Cohen, M., & Perkins, P. E. (Dir.), Gender, climate justice, and transformative leadership. Routledge.
Reed, G., Fox, S., Littlechild, D., McGregor, D., Lewis, D., Popp, J., Wray, K., Kassi, N., Ruben, R., Morales, S., & Lonsdale, S. (2024). For our future: Indigenous resilience report [Pour notre avenir : Rapport sur la résilience autochtone]. Natural Resources Canada. Extrait de https://www.changingclimate.ca/indigenous-resilience/.
Reyes-García, V., García-Del-Amo, D., Porcuna-Ferrer, A., Schlingmann, A., Abazeri, M., Attoh, E. M. N. A. N., & LICCI Consortium. (2024). Local studies provide a global perspective of the impacts of climate change on Indigenous Peoples and local communities [Les études locales offrent une perspective mondiale des impacts du changement climatique sur les peuples autochtones et les communautés locales]. Sustainable Earth Reviews, 7(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s42055-023-00063-6.
Sarkar, A., Hanrahan, M., & Hudson, A. (2015). Water insecurity in Canadian Indigenous communities: Some inconvenient truths [Insécurité hydrique dans les communautés autochtones canadiennes : Quelques vérités qui dérangent]. Rural and Remote Health, 15, 3354. https://doi.org/10.22605/RRH3354.
Simms, R., Harris, L., Joe, N., & Bakker, K. (2016). Navigating the tensions in collaborative watershed governance: Water governance and Indigenous communities in British Columbia, Canada [Naviguer les tensions dans la gouvernance collaborative des bassins versants : Gouvernance de l’eau et communautés autochtones en Colombie-Britannique, Canada]. Geoforum, 73, 6–16. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.04.005.
Tamufor, N. E., Roth, R., & MacDonald, D. B. (2025). Biodiversity conservation policy reform and reconciliation in Canada: An analysis of the pathway to Canada Target 1 through the policy cycle model [Réforme de la politique de conservation de la biodiversité et réconciliation au Canada : Une analyse du chemin vers la Cible 1 du Canada à travers le modèle du cycle des politiques]. Frontiers in Environmental Science, 12, 1434731. https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1434731.
Thomson, V. (2024). Decolonization, feminism, and climate: A commentary on Misdzi Yikh v. Canada [Décolonisation, féminisme et climat : Un commentaire sur Misdzi Yikh c. Canada]. McGill Journal of Sustainable Development Law, 18(2), 157–179.
Tran, D., Martínez-Alier, J., Navas, G., & Mingorráda, S. (2020). Gendered geographies of violence: A multiple case study analysis of murdered women environmental defenders [Géographies genrées de la violence : Une analyse d’études de cas multiples de femmes défenseures de l’environnement assassinées]. Journal of Political Ecology, 27, 1189–1216. https://doi.org/10.2458/v27i1.23160.
Venkataraman, M., Grzybowski, S., Sanderson, D., Fischer, J., & Cherian, A. (2022). Environmental racism in Canada [Racisme environnemental au Canada]. Canadian Family Physician, 68(8), 567–569. https://doi.org/10.46747/cfp.6808567.
Williams, L., Fletcher, A., Hanson, C., Neapole, J., & Pollack, M. (2018). Women and climate change: Impacts and action in Canada [Les femmes et le changement climatique : Impacts et actions au Canada]. Canadian Research Institute for the Advancement of Women.
Yarchuk, K., Northrup, J., Menzies, A., Perron, N., Kemp, C., Noganosh, S., & Popp, J. (2024). Co-creating ethical space in wildlife conservation: A case study of moose (Mooz; Alces alces) research in Ontario, Canada [Cocréer un espace éthique dans la conservation de la faune : Une étude de cas sur la recherche sur l’orignal (Mooz; Alces alces) en Ontario, Canada]. FACETS, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.1139/facets-2023-0112.
Zambrano-Alvarado, J. I., & Uyaguari-Diaz, M. I. (2024). Insights into water insecurity in Indigenous communities in Canada: Assessing microbial risks and innovative solutions, a multifaceted review [Aperçu de l’insécurité hydrique dans les communautés autochtones au Canada : Évaluation des risques microbiens et solutions innovantes, une revue multifacette]. PeerJ, 12, e18277. https://doi.org/10.7717/peerj.18277.